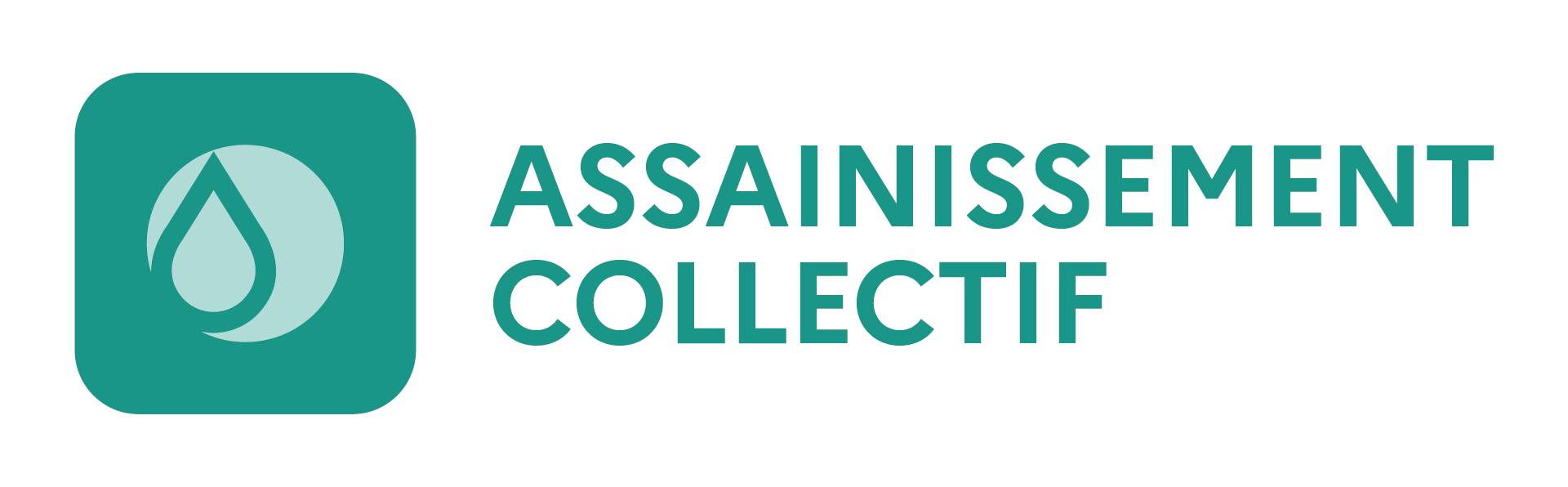- Maîtrise des pollutions : pour les faibles pluies, préserver ou restaurer la qualité des milieux récepteurs par la maîtrise des flux de pollution en temps de pluie et la limitation des phénomènes d’érosion; favoriser l'alimentation des nappes d'eaux souterraines;
- Prévention des inondations : pour les pluies plus importantes, limiter les inondations liées au ruissellement pluvial ou aux débordements des systèmes d'assainissement; en cas d'événement exceptionnel, assurer la sécurité des biens et des personnes;
- Continuité de l'assainissement : limiter la dégradation du fonctionnement des stations de traitement des eaux usées (STEU) par temps de pluie et les risques de non conformité;
- Prise en compte dans l'aménagement : penser l'aménagement en intégrant les trois enjeux précédents afin de réaliser des systèmes de gestion des eaux pluviales capables de gérer différentes pluies; faire des eaux pluviales un levier de valorisation des projets d'aménagement, ce qui nécessite un spectre de compétences (ingénieurs, urbanistes, paysagistes, ...).
- adapter le choix des revêtements de chaussées et autres matériaux urbains (matériaux neutres); vérifier l’origine des matériaux et leur absence de contamination;
- utiliser des peintures de sols et autres matériaux sans adjuvants toxiques;
- modifier les pratiques locales de nettoyage des rues (fréquence accrue du nettoyage); sensibiliser sur la nécessité de ne pas rejeter de détritus sur la voie publique;
- contrôler et réduire l’utilisation des engrais, herbicides, pesticides et autres produits phytosanitaires; utiliser de manière plus réfléchie les produits de déneigement et de déverglaçage;
- améliorer l’efficacité des systèmes de dépollution des systèmes industriels producteurs de fumée; améliorer la gestion des aires de stockage industrielles;
- promouvoir les transports en commun; améliorer la conception des véhicules de manière à diminuer les émissions de polluants et à améliorer la combustion des matières organiques.
Bienvenue sur la rubrique "Gestion des eaux pluviales" du portail
a rubrique 2.1.5.0 ne couvre pas les rejets dans les réseaux d'assainissement, c’est-à-dire qu’un maître d’ouvrage n’a pas à déposer de dossier Loi sur l’Eau auprès des services de l’État (il devra cependant bénéficier d’une autorisation de raccordement de la part du gestionnaire du réseau).
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, afin d'assurer la sécurité publique (prévention des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports de pollution dans les milieux aquatiques).
Depuis plusieurs années, le Ministère de la Transition Ecologique encourage fortement différents acteurs à prendre cet enjeu en compte très en amont dans l’aménagement.
Aujourd'hui, malgré un patrimoine et des responsabilités partagés, l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales se différencient fortement. Le Ministère de la Transition Ecologique met ainsi à disposition ce portail d'informations. Vous y trouverez des informations et références documentaires sur :
Des exigences accrues de préservation des milieux aquatiques
 La Directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) de mai 1991 a défini des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Ces obligations ont été transcrites en droit français dans la réglementation relative à l'assainissement collectif. Elles concernent également les eaux pluviales lorsque celles-ci sont mélangées aux eaux usées dans les réseaux d'assainissement unitaires.
La Directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) de mai 1991 a défini des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Ces obligations ont été transcrites en droit français dans la réglementation relative à l'assainissement collectif. Elles concernent également les eaux pluviales lorsque celles-ci sont mélangées aux eaux usées dans les réseaux d'assainissement unitaires.
Par la suite, la Directive européenne Cadre sur l'Eau (DCE) d'octobre 2000, progressivement transposée dans le droit français, a fixé une obligation de résultat visant le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de leur état actuel. Les différents objectifs de résultat sont déclinés au niveau français dans les [kag[ib:{header=[Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - SDAGE]},{body=[Institué par la Loi sur l’Eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Loi sur l’Eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau.]}Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux]kag] (SDAGE).
On sait aujourd'hui que les déversements et rejets dans les milieux aquatiques en temps de pluie peuvent également générer des dégradations momentanées ou durables des milieux. Les [kag[i1:{header=[Pollutions de temps de pluie]},{body=[Lors d'une pluie, différents vecteurs potentiels de pollution existent:
* les eaux de pluie qui, en lessivant l’atmosphère, peuvent naturellement se charger en polluants présents dans l'air (pesticides, HAPs,...); les concentrations en polluants sont cependant très faibles dans la plupart des cas et ne présentent pas de risques;
* les eaux pluviales, c'est-à-dire l'eau de pluie qui, arrivée sur le sol, ruisselle sur différentes surfaces et se charge en différents polluants produits par les constructions et les activités humaines (poussières, hydrocarbures, pesticides, métaux,...);
* les rejets d'eaux pluviales, c'est-à-dire les eaux pluviales qui, après avoir été collectées et transportées dans un réseau, sont rejetées dans le milieu naturel; lors de leur parcours dans les réseaux, ces eaux pluviales vont remettre en suspension des matières déposées qui peuvent accumuler des polluants (déchets des passants, produits de nettoyage des rues,..);
* les rejets urbains de temps de pluie, c'est-à-dire les déversements des systèmes d'assainissement à partir d'une certaine pluie; lorsque le système est unitaire ou que la séparativité des réseaux est défaillante (inversion de branchements), ces déversements contiennent notamment des matières organiques et azotées ayant un fort impact sur la qualité des eaux et la vie aquatique.
]}pollutions de temps de pluie]kag] constituent vraisemblablement des sources importantes d'apport de micropolluants aux milieux aquatiques (zinc, cuivre, ammonium, pesticides,...), ce qui peut compromettre les usages de la ressource en eau (zones de baignade, loisirs, pêche).
L'importance de s'intéresser aux eaux pluviales
 Bien que les textes relatifs à la gestion des eaux pluviales ne fixent pas pour la collectivité d'obligation de collecte ou de traitement en tant que telle, ce contexte, couplé aux problématiques d'inondations par ruissellement ou débordement de réseaux, renforce l'attention à porter à la gestion des eaux pluviales, notamment en lien avec le patrimoine d'ouvrages existants.
Bien que les textes relatifs à la gestion des eaux pluviales ne fixent pas pour la collectivité d'obligation de collecte ou de traitement en tant que telle, ce contexte, couplé aux problématiques d'inondations par ruissellement ou débordement de réseaux, renforce l'attention à porter à la gestion des eaux pluviales, notamment en lien avec le patrimoine d'ouvrages existants.
En temps de pluie, les systèmes d’assainissement, qu’ils soient unitaires ou séparatifs, rencontrent de manière récurrente des difficultés à collecter, transporter et/ou stocker les eaux pluviales. Selon l'importance des pluies, cette situation peut provoquer des déversements et des débordements, pouvant conduire à des inondations. L’[kag[i1:{header=[Artificialisation des sols]},{body=[Les sols peuvent être répartis en trois catégories : les sols naturels (forêts, landes, zones humides, roches, sols nus,…), les sols cultivés et en herbe (champs,…) et les sols artificialisés. Les espaces artificialisés, majoritairement modifiés par les activités humaines, comprennent :
* les sols bâtis, clos et/ou couverts comme les immeubles et maisons d’habitation, les immeubles de bureaux ou commerciaux, les usines et les bâtiments agricoles, les halles de marchés, les quais de gare ou les hangars agricoles;
* les sols revêtus ou stabilisés tels que les routes, autoroutes, voies ferrées, chemins forestiers et agricoles, places, squares, ronds-points, parcs de stationnement;
* d’autres sols comme les mines, carrières, décharges, chantiers, terrains vagues, ainsi que les espaces verts artificialisés (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs).
En 2010, près de 9% du territoire français, soit 4,9 millions d'hectares, était artificialisé et ce chiffre ne cesse de croître. Aujourd’hui, la progression des sols artificialisés se fait principalement aux dépens des terres agricoles.
Source : Agreste – Service de la Statistique et de la Prospective (SSP)]}artificialisation des sols]kag] contribue à l'aggravation de ces phénomènes en rendant les sols moins perméables. En effet, l'imperméabilisation des sols limite l'infiltration des eaux pluviales dans le sol et l'alimentation des eaux souterraines, et augmente ainsi les volumes d’eaux ruisselés.
Quels objectifs intégrer dans l'aménagement ?
Pour répondre à ces enjeux, de nombreuses collectivités ont dû s'engager depuis des dizaines d'années dans des programmes de travaux et d'équipements des systèmes d'assainissement. Pour les décideurs locaux, les eaux pluviales sont ainsi l'un des aspects essentiels à prendre en compte dans la planification et l'aménagement de leur territoire. Les objectifs visés sont nombreux:
Pour limiter les apports d'eaux pluviales, le développement d'approches plus intégrées à l'urbanisme s'avère donc nécessaire et était déjà promu par le guide « La ville et son assainissement », selon une logique de [kag[i1:{header=[Niveaux de service ]},{body=[Introduits par le guide La Ville et son Assainissement (MEDD, Certu, 2003), les niveaux de service formalisent le principe selon lequel le fonctionnement des systèmes d'assainissement, et notamment des systèmes de gestion des eaux pluviales, doit être étudié pour toute condition pluviométrique.
Pour les systèmes de gestion des eaux pluviales, le tableau ci-dessous explicite par niveau de service les objectifs prioritaires susceptibles d'être visés.
Source : Repères à destination des instructeurs de la police de l'eau et des milieux aquatiques, Juin 2011, DGALN, Certu, Agences de l'Eau)]}niveaux de service]kag] assurés par le système de gestion des eaux pluviales.
Réduire les émissions de polluants et le ruissellement à la source
Concernant la maîtrise des pollutions, une meilleure gestion des eaux pluviales passe avant tout par une approche préventive visant la limitation à la source des apports de pollution. Pour cela, les opérations à promouvoir sont nombreuses et dépassent le cadre de compétences des services en charge de la gestion des eaux pluviales, par exemple:
Un second levier d'action réside dans la limitation de l’imperméabilisation afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de limiter le lessivage des sols et surfaces urbaines.
Gérer les eaux pluviales au plus près de leur point de chute
 Outre ces mesures préventives, on cherchera ensuite à privilégier une gestion à l’amont des eaux pluviales c’est-à-dire, lorsque les caractéristiques du projet et de l’environnement le permettent, une gestion au plus près de leur point de chute, respectueuse du cycle de l’eau. De grands principes sont à respecter: éviter de collecter les eaux pluviales dans des réseaux d’assainissement (unitaires ou séparatifs), limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l'érosion et le lessivage des sols, éviter la concentration des écoulements, favoriser l'évaporation de l'eau et l'évapotranspiration par la végétation.
Outre ces mesures préventives, on cherchera ensuite à privilégier une gestion à l’amont des eaux pluviales c’est-à-dire, lorsque les caractéristiques du projet et de l’environnement le permettent, une gestion au plus près de leur point de chute, respectueuse du cycle de l’eau. De grands principes sont à respecter: éviter de collecter les eaux pluviales dans des réseaux d’assainissement (unitaires ou séparatifs), limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l'érosion et le lessivage des sols, éviter la concentration des écoulements, favoriser l'évaporation de l'eau et l'évapotranspiration par la végétation.
Lorsque la nature du sol le permet, on cherchera à infiltrer les eaux pluviales pour les pluies courantes, sur le principe des [kag[i1:{header=[Niveaux de service]},{body=[Introduits par le guide La Ville et son Assainissement (MEDD, Certu, 2003), les niveaux de service formalisent le principe selon lequel le fonctionnement des systèmes d'assainissement, et notamment des systèmes de gestion des eaux pluviales, doit être étudié pour toute condition pluviométrique.
Pour les systèmes de gestion des eaux pluviales, le tableau ci-dessous explicite par niveau de service les objectifs prioritaires susceptibles d'être visés.
Source : Repères à destination des instructeurs de la police de l'eau et des milieux aquatiques, Juin 2011, DGALN, Certu, Agences de l'Eau)]}niveaux de service.]kag] Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre prennent différentes formes: noues, tranchées, jardins de pluie, bassins paysagers, espaces inondables intégrés à l'aménagement,...
Une gestion des eaux pluviales à la source se veut complémentaire d'une gestion séparative en limitant les apports d'eaux pluviales à prendre en charge par les systèmes d'assainissement existants.
Par ailleurs, les eaux pluviales peuvent constituer une nouvelle ressource en tant que support de nature en ville et de biodiversité, d'animation paysagère, de lutte contre les îlots de chaleur urbains (accroissements localisés des températures en zones urbaines).
Les fossés et noues végétalisées

Une noue est un fossé large et peu profond aux formes adoucies. Les eaux pluviales sont stockées et s’infiltrent (noues d'infiltration) et/ou s’écoulent vers les eaux de surface ou un réseau de collecte superficiel ou enterré (noues de rétention).
Principe de fonctionnement d'une noue ou d'un fossé d'infiltration
Principe de fonctionnement d'une noue ou d'un fossé de rétention
Les noues peuvent être engazonnées, enherbées ou bien encore plantées. Faciles de mise en œuvre, elles permettent la création d’un paysage végétal et d'espaces verts qui rendent visible le chemin des eaux pluviales.
En cas de pentes importantes, des cloisons peuvent être mises en place afin d'augmenter le volume de stockage et réduire les vitesses d'écoulement.
Les tranchées drainantes

Les tranchées drainantes sont des ouvrages linéaires de faible profondeur comblés de matériaux poreux. Elles assurent le stockage temporaire des eaux pluviales avant infiltration (tranchées d'infiltration) et/ou restitution à débit contrôlé vers les eaux de surface ou un réseau de collecte superficiel ou enterré (tranchées de rétention). L’eau est amenée soit par des drains ou des canalisations, soit par ruissellement diffus.
Principe de fonctionnement d'une tranchée végétalisée
Principe de fonctionnement d'une tranchée non couverte
Les tranchées peuvent s’insérer dans de nombreux espaces urbains, au niveau d’accotements, sous trottoirs, en périphérie de bâtiments. Pour leur réalisation, une pente d'au moins 2 à 3% est à privilégier. En cas de pentes importantes, la réalisation de la tranchée peut inclure des cloisons pour augmenter le volume de stockage.
Si la tranchée est circulée ou se trouve à proximité d'une voirie, il est nécessaire de s'assurer de la bonne résistance mécanique de l'ouvrage.
Les puits d'infiltrations

Les puits sont des ouvrages qui permettent le transit des eaux pluviales vers un horizon perméable du sol pour assurer leur infiltration, après stockage et prétraitement éventuels.
Principe de fonctionnement d'un puits d'infiltration
Les puits peuvent constituer une solution intéressante dans des zones privées d'exutoire (points bas) ou dans des secteurs fortement contraints (faible emprise foncière disponible).
Les puits peuvent être couplés à d'autres ouvrages de gestion des eaux pluviales, en permettant par exemple la vidange de noues et fossés végétalisés ou de bassins d'infiltration.
L’injection des eaux pluviales directement dans la nappe phréatique est à proscrire.
Les chaussées à structure-réservoir

Une chaussée à structure réservoir assure le stockage des eaux pluviales à l'intérieur du corps de chaussée, dans les vides du matériau. L'eau est collectée soit localement par un système d'avaloirs et de drains, soit par infiltration répartie à travers un revêtement drainant en surface.
Principe de fonctionnement d'une chaussée à structure réservoir (revêtement perméable+infiltration dans le sol, revêtement étanche+infiltration dans le sol, revêtement perméable+évacuation à débit contrôlé vers exutoire, revêtement étanche+évacuation à débit contrôlé vers exutoire)
Selon le matériau de stockage retenu, la porosité utile s’étend de 15 à 90%. Pour des pentes supérieures à 1%, une adaptation de la conception de l'ouvrage peut être nécessaire afin d'éviter une accumulation de l'eau dans les points bas de la chaussée.
Au-delà de ses fonctions hydrauliques et mécaniques, une chaussée à structure réservoir réduit le bruit de roulement et les projections d'eau lorsqu’elle est surmontée d'un revêtement poreux.
Les bassins à ciel ouvert
 L'eau est collectée par un ouvrage d'arrivée, stockée dans le bassin puis restituée par infiltration dans le sol (bassins d'infiltration) ou à débit contrôlé vers les eaux de surface ou un réseau de collecte superficiel ou enterré (bassins de retenue). Parmi les bassins de retenue, on distingue les bassins en eau, qui conservent une lame d'eau en permanence, et les bassins sec, qui sont vides la majeure partie du temps.
L'eau est collectée par un ouvrage d'arrivée, stockée dans le bassin puis restituée par infiltration dans le sol (bassins d'infiltration) ou à débit contrôlé vers les eaux de surface ou un réseau de collecte superficiel ou enterré (bassins de retenue). Parmi les bassins de retenue, on distingue les bassins en eau, qui conservent une lame d'eau en permanence, et les bassins sec, qui sont vides la majeure partie du temps.
[kag[f1:{{https://www2.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/lien9.php}}Principe de fonctionnement d'un bassin sec d'infiltration]kag]
[kag[f1:{{https://www2.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/lien10.php}}Principe de fonctionnement d'un bassin de retenue en eau]kag]
Les bassins à ciel ouvert s'intègrent dans les espaces publics (places, aires de jeux, terrains de sport) et participent à l'aménagement paysager et à la création de zones vertes, voire bleues. Ces fonctions secondaires rendent nécessaire l'entretien des ouvrages et contribuent ainsi à leur pérennité.
La hauteur d’eau dans les bassins devra rester compatible avec la sécurité des personnes, ce qui permettra par ailleurs d’éviter un isolement de l'ouvrage (par des barrières par exemple).
Les bassins enterrés

Contrairement aux bassins à ciel ouvert, les ouvrages enterrés de génie civil peuvent être situés sous parkings, voiries légères ou lourdes, selon la technique de réalisation employée. On distingue en effet plusieurs techniques, des buses et cuves en béton ou métalliques aux ouvrages comblés de produits creux en béton ou de Structures Alvéolaires Ultra-légères (SAUL).
Les bassins enterrés présentent un intérêt dans des secteurs fortement contraints (faible emprise foncière disponible) et peuvent supporter différentes activités sous réserve d'un dimensionnement mécanique adapté, en parallèle du dimensionnement hydraulique de l'ouvrage.
Les modalités d’évacuation de l’air dans l’ouvrage lors de son remplissage (évent,...) et de surverse éventuelle vers des zones de faible vulnérabilité en cas de pluies importantes doivent être prises en compte lors de la phase de conception.
Les toitures terrasses

Les toitures terrasses, végétalisées ou non, permettent de retenir temporairement la pluie avant de la restituer via des descentes d'eaux pluviales connectées à d'autres ouvrages de gestion des eaux pluviales ou à un réseau de collecte superficiel ou enterré. Elles favorisent également l’évapo(transpi)ration des eaux.
Coupe type d'une toiture végétalisée
Coupe type d'une toiture terrasse
Différents types de toitures végétalisées peuvent être réalisés, du jardin sur le toit (toiture intensive) au "tapis de sedum" (toiture extensive). Elles sont toutes basées sur la même structure multi-couches: végétaux, substrat, couche de drainage et/ou stockage. Il est à noter que même les toitures en pente peuvent être végétalisées. Afin d'éviter que l'étanchéité ne soit endommagée par les racines des végétaux introduits, il est nécessaire de mettre en place une étanchéité anti-racines.
En parallèle du dimensionnement hydraulique de la toiture (végétalisées ou non), un dimensionnement mécanique est nécessaire (portance de la toiture).
Le Cerema a réalisé, en 2017, un outil de calcul "FAVEUR" pour évaluer les performances hydriques des toitures végétalisées (gratuit).
Les jardins de pluie

Un jardin de pluie est un micro-jardin formé d'une légère dépression et végétalisé par des plantes palustres, voire parfois aquatiques. Il est exclusivement alimenté avec des eaux pluviales provenant généralement de toitures ou de zones pavées, acheminées via une gouttière ou un autre type de collecteur. Les eaux pluviales sont restituées par infiltration ou rejet vers d'autres ouvrages (noues, bassins de rétention), les eaux de surface ou un réseau de collecte superficiel ou enterré.
De conception assez simple, ils contribuent à la création d’un paysage végétal formant un petit réservoir de biodiversité. Le jardin de pluie est utilisé sur des sites de moins de un hectare. Pour des projets plus grands, plusieurs jardins de pluie pourront être créés.
Les végétaux sont sélectionnés pour leur contribution à la biorétention (propriétés chimiques, biologiques et physiques des plantes et des sols). Les plantes sélectionnées doivent être adaptées à la région et aux conditions particulières du sol et d'ensoleillement.
La réutilisation des eaux de pluie

Les eaux de pluie stockées peuvent constituer une ressource alternative pour des usages ne requérant pas une eau potable, comme par exemple l'arrosage. La réglementation (Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments) définit les usages de l'eau de pluie autorisés, les bâtiments dans lesquels l'eau de pluie ne peut être utilisée et les exigences techniques à satisfaire par les installations. L'eau de pluie utilisée est uniquement l'eau issue des toitures inaccessibles.
Un dispositif d'utilisation de l'eau de pluie est-il un ouvrage de gestion des eaux pluviales?
Les cuves enterrées ou aériennes, les tonneaux récupérateurs, etc. ne permettent pas de remplir les mêmes fonctions que tout autre ouvrage de gestion des eaux pluviales. En effet, une cuve d'eau de pluie contribue à limiter les volumes d'eaux pluviales rejetés mais ne garantit pas une maîtrise des débits. Pour y remédier, une adaptation de conception est nécessaire avec, par exemple, des cuves compartimentées ou une gestion du trop-plein de la cuve par infiltration et non par rejet au réseau d'assainissement.
Intégrer les eaux pluviales dans les projets d'aménagement
Afin de répondre aux exigences qui s'appliquent à son projet, qu'il s'agisse d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, le pétitionnaire pourra recourir à des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui visent à recueillir, stocker temporairement puis restituer les eaux pluviales au milieu récepteur, en cherchant à se rapprocher du cycle naturel de l'eau.
Ces ouvrages de recueil, stockage et restitution des eaux pluviales recouvrent une vaste palette de techniques pour différentes natures et tailles de projets (maisons individuelles, lotissements, ZAC,...) et différentes contraintes locales. Parmi eux, les espaces à ciel ouvert et les espaces végétalisés peuvent coupler une fonction hydraulique avec une fonction paysagère et récréative. Certains aménagements peuvent également être conçus comme des espaces temporairement inondables en cas de fortes pluies (stades, parkings,...).
Les principaux types d'ouvrages sont succinctement présentés ci-dessous. Chacun d'eux peut faire l’objet d’une grande variété de conception et d’intégration dans l’aménagement.
Documents et liens utiles
° Recueil des textes réglementaires relatifs à la gestion des eaux pluviales
Sites d'associations dans le domaine de la gestion des eaux pluviales :
° Site du Graie (Groupe de Recherche Animation technique et Information sur l'Eau)
° Site de l’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d'eaux pluviales - ADOPTA.